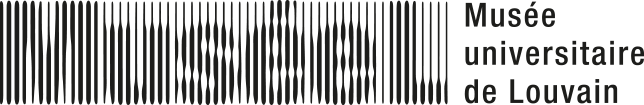Cette œuvre monumentale, qui propose la première synthèse écrite sur l’histoire d’une institution souvent désignée comme inutile tout en étant essentielle, me touche. De fait, elle est alimentée par une vibration émotionnelle constante notamment devant les superbes Rubens conservés aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Son émotion est rejointe par une érudition sans frontière qui prend en compte par exemple la politique de pays confisquant l’accès au patrimoine ainsi qu’une réflexion philosophique sur les rôles et les publics du musée. C’est pourquoi il dit que « l’invention du musée est d’abord une révolution du regard, de la place du sacré et du temps ». Le musée, selon Krzysztof Pomian, est ce qui permet « une rupture intellectuelle et sensorielle ». Et d’ajouter que dans toute période de rupture, il observe « le besoin de garder la mémoire du passé » suffisamment vivace « pour préserver les liens et pour transmettre ». Nous vivons certainement une période de ruptures dont les contours sont encore confus.
Ce qui nous anime au Musée L dans ce contexte, c’est bien le sens donné à la préservation et à la transmission. Elles s’appuient tant sur l’émotion suscitée par l’objet ou l’œuvre d’art réels que sur le développement des connaissances intellectuelles alimentant la réflexion. Louvain 2020 (p. 5), porté par la Professeure Charlotte Langohr, partage cette démarche qui a irrigué une série de projets interdisciplinaires riches d’enseignements pour chacun. D’un côté, l’accès aux collections et objets, l’essence même de la base d’un musée laboratoire, nous permet toujours de répondre aux demandes des professeurs et de leurs étudiants. Mais, d’un autre côté, nous développons également des accès virtuels novateurs pour rencontrer les publics actuels dont les adolescents. C’est ce que Marie Resseler (p.11) vous présente dans l’expérience menée lors du stage créatif à distance cet été. Enfin, l’exposition STAGED BODIES, unanimement saluée comme une réussite, dévoile son back staged. Douglas Crimp affirme que « derrière chaque image, se cache toujours une autre image ». Sur ces mots, je vous invite à une grande partie de cache-cache visuel. A-Musez-Vous !